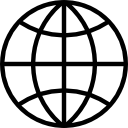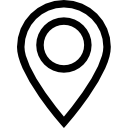Les troubles anormaux du voisinage :
un nouveau cadre juridique inscrit
dans le Code civil
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, longtemps ancrée dans la jurisprudence, bénéficie désormais d'une reconnaissance légale avec l'entrée en vigueur de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024.
Cette loi vise à réduire les contentieux de voisinage, particulièrement en zone rurale, tout en adaptant le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels. Elle s’inscrit dans la lignée de la loi n° 2021-85 du 29 juin 2021 dite « loi Maurice », visant à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises.
Pour mieux comprendre cette évolution, il est essentiel de revenir sur les fondements de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, son nouveau cadre légal et ses implications pratiques.
La théorie des troubles anormaux du voisinage, issue de la jurisprudence, repose depuis longtemps sur un fondement autonome consacré par la Cour de cassation, qui affirme le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage » (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n°84-16.379).
De manière générale, la cohabitation entre voisins entraîne des nuisances (olfactives, sonores ou visuelles) que chacun doit tolérer. Cependant, lorsque ces nuisances dépassent les désagréments ordinaires du voisinage et deviennent anormales, l’auteur du trouble peut être contraint d’indemniser son voisin.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage. Les juges apprécient souverainement la gravité des troubles, en tenant uniquement compte de l’existence d’un trouble qui « excède les inconvénients normaux de voisinage » (Cass. 2e civ. 16 juill. 1969). Ainsi, l'absence de faute de l'auteur du trouble ne l'exonère pas sa responsabilité.
Le nouvel article 1253 du Code civil précise le champ d’application de cette responsabilité et ses limites. En outre, un nouvel article L. 311-1-1 a été inséré dans le Code rural et de la pêche maritime afin de prévoir des exonérations spécifiques aux activités agricoles
1) Le champ d’application de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage
Le nouvel article 1253 du Code civil dispose, dans son alinéa premier, que :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
L'apport de cet alinéa réside dans l’énumération des personnes pouvant être mises en cause sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Une action fondée sur un trouble anormal de voisinage peut donc être engagée à l'encontre du propriétaire, du locataire, de l'occupant sans titre, du bénéficiaire d'un titre autorisant l'occupation ou l'exploitation d'un fonds, ainsi que du maître d'ouvrage ou de celui qui en exerce les pouvoirs.
La question qui se pose est de savoir si cette liste est exhaustive. À ce jour, la jurisprudence n'apporte pas encore de réponse à cette interrogation.
À première vue, le texte se contente de reprendre les conditions établies par la jurisprudence jusqu'à présent, sans y apporter de modifications notables. Cela implique également que les anciennes solutions jurisprudentielles devraient demeurer applicables. Ce serait le cas de l'arrêt du 16 mars 2022 n° 18-23.954, qui réaffirme le caractère objectif de cette responsabilité.
La question posée dans cet arrêt était de savoir si un acquéreur peut être tenu responsable des troubles anormaux de voisinage dont l'origine est antérieure à l'acquisition du fonds. La réponse est affirmative : « l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit ». Ainsi, l’acquéreur est tenu responsable même si le trouble a débuté avant qu'il n'ait acquis la propriété du fonds.
Néanmoins, l’alinéa 1er du nouvel article 1253 du Code civil exclut expressément l'entrepreneur de la liste des personnes pouvant être mises en cause. Traditionnellement, en cas de nuisances causées par des travaux, seule une action contre le maître de l’ouvrage était admise. Cependant, la Cour de cassation avait d’abord reconnu la possibilité d’agir contre l’entrepreneur en invoquant la notion de voisin occasionnel (Civ. 1re, 18 mars 2003, n° 99-18.720), avant de privilégier une approche fondée exclusivement sur le lien de causalité (Civ. 3e, 9 févr. 2011, n° 09-71.570 ; Civ. 3e, 28 avr. 2011, n° 10-14.516). Cette dernière approche permettait d’agir contre l’entrepreneur lorsque celui-ci avait contribué, en tout ou en partie, à la survenance du trouble de voisinage. Désormais, il semble que le législateur choisit de revenir à la solution traditionnelle, limitant la responsabilité, en cas de nuisances causées par des travaux, au seul maître de l'ouvrage et excluant expressément toute action contre l'entrepreneur.
2) Le régime de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage
Le deuxième alinéa de l’article 1253 du Code civil précise que :
« Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble normal ».
L'alinéa 2 de l’article 1253 du Code civil limite l'engagement de la responsabilité de l'auteur du trouble lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- Si l'activité est antérieure à l'installation de la personne se plaignant d'un trouble de voisinage,
- Si l’activité respecte le cadre législatif et réglementaire en vigueur,
- Si l'activité se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine de l'aggravation du trouble anormal de voisinage.
Il s’agit d’une reprise de la théorie de la préoccupation de l’ancien article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation. Cet article, désormais abrogé, disposait que :
« Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
Ainsi, le nouvel article 1253 du Code civil apporte quelques modifications au régime de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. Les exonérations sont plus larges car, antérieurement à la réforme, seules les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques étaient concernées. Désormais, toutes les activités sont visées. Par ailleurs, le nouvel article 1253 du Code civil admet que l'activité puisse se poursuivre dans des conditions nouvelles, à condition qu’elle ne soit pas à l'origine de l'aggravation du trouble anormal de voisinage.
3) Le cas spécifique des activités agricoles
Le nouvel article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime énonce que :
« La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité ».
Par conséquent, une cause d’exonération supplémentaire est prévue spécifiquement pour les activités agricoles. Notamment, la responsabilité ne pourra pas être engagée si l'activité a été poursuivie dans des conditions nouvelles, à condition qu’elles résultent de la mise en conformité de l’exercice avec les lois et règlements, ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. Il peut s’agir, en l’occurrence, d’un accroissement de l’activité de l’exploitation.
Maître ICHON se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de vos contentieux de voisinage.